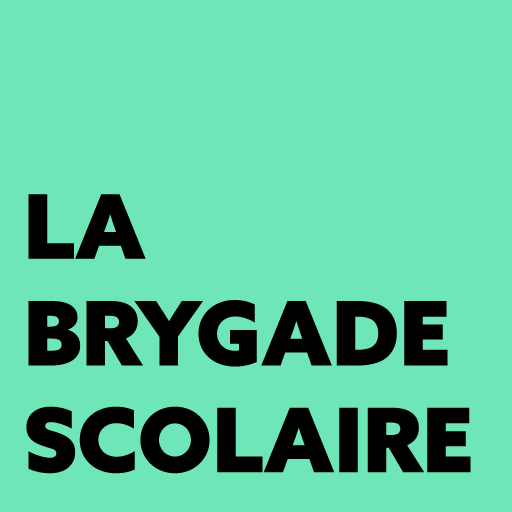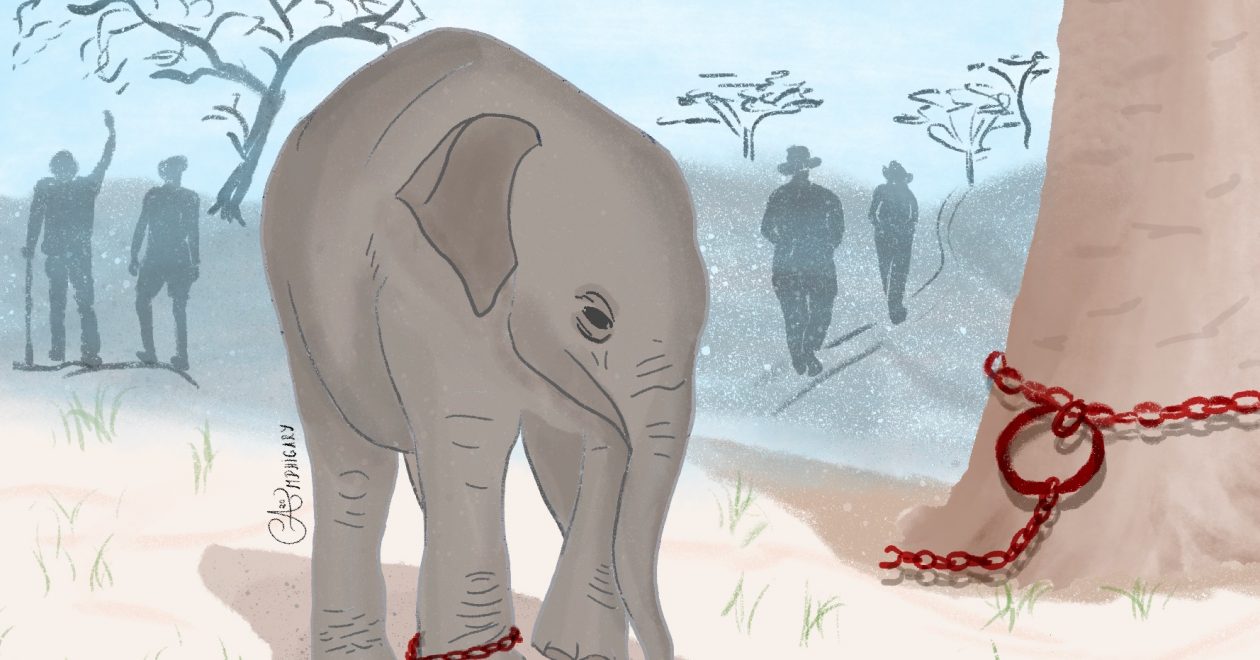
L’impuissance apprise
1. L'impuissance apprise ou l'éléphant prisonnier
A l’âge de bronze, le Fer était un métal rare et précieux. Le bronze n’était pas assez solide pour attacher un éléphant. Les Cornacs, responsable de l’élevage des éléphants, avaient compris que la meilleure façon était de l’attacher était dans la tête. Pour cela, ils décidèrent d’attacher les éléphanteaux par une corde à un poteau dès leur plus jeune âge. L’éléphanteau pèse alors une centaine de kilos, il tente de tirer la corde, de bouger mais c’est impossible. En grandissant, il grandit, grossit, et développe sa force. La corde est toujours la même. Il suffirait de peu pour que l’éléphant retrouve sa liberté. Mais, il n’essaye même pas. Pourquoi ? Il a APPRIS que la corde était incassable. Il avait intégré dans son conditionnement que la corde était invincible du coup il ne bougeait pas.
2. "L'impuissance" apprise à l'école
Le système actuel d’évaluation des compétences à l’école n’a tendance à valoriser que les résultats et non les processus de réflexion. Seules les notes comptent et les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues ne sont jamais étudiées (échecs comme succès). Or, analyser ses réussites et ses échecs conduit à une meilleure maîtrise de ses apprentissages.
Être conscient de ses forces et faiblesses permet de rebondir, d’axer ses efforts sur des points d’achoppement. Ainsi, une réussite devient envisageable et l’élève retrouve le contrôle de lui-même. Fonder son estime de soi sur les seuls résultats scolaires empêche de se donner les moyens de progresser.
Il faut donc insister sur ces « processus de réflexion » et analyser les conditions dans lesquelles chaque note est obtenu, afin qu’en cas d’échec, des solutions personnalisées soient mises en place afin de remédier aux éventuelles lacunes.
3. Remédier à l'impuissance apprise
Nelson Mandela : « Je ne perds jamais. Sois je gagne, soit j’apprends. »
Redonner sa place à l’erreur
Nelson Mandela : « Je ne perds jamais. Sois je gagne, soit j’apprends. » Dire à un jeune qu’il ne maîtrise « pas encore » une compétence, plutôt que « pas du tout » ouvre une perspective dynamique. Et la voie d’une réussite à venir. C’est quand on se trompe qu’on apprend. Pourquoi ? En fait, ceci n’est vrai que si l’on a conscience de son implication personnelle dans les insuccès répétés. Non pas en termes de responsabilité imputable à ses talents, mais plutôt au regard des efforts que l’on peut fournir pour trouver une solution. En changeant notre point de vue sur nos performances, nous pouvons nous placer en situation de progresser. C’est tout le propos de la psychologie positive. Enrayer la spirale de l’échec, restaurer la confiance en soi en atteignant des objectifs raisonnables. Apprendre sur soi, c’est comprendre nos propres façons d’apprendre, et donc de réussir. Mais malheureusement, le plus souvent, la résignation des élèves laisse l’institution sans réponses opérantes.
Churchill : « Le succès est l’aboutissement d’une succession d’échecs »
L’échec : La clé du succès
Churchill “Le succès est l’aboutissement d’une succession d’échecs”. Sortir de l’Impuissance Apprise nécessite de reprogrammer notre cerveau en ce qui concerne la notion d’échec. En effet, comme nous le disons souvent, l’erreur et l’échec sont essentiels, ils sont le terreau de l’apprentissage. Ne pas échouer, c’est stagner et rester au même niveau de connaissance. Il faut apprendre à considérer l’échec comme une étape essentielle de développement et une occasion de progresser.
Du point de vue de l’élève
“L’erreur n’est pas seulement l’effet de l’ignorance, de l’incertitude, du hasard […] , mais l’effet d’une connaissance antérieure, qui avait son intérêt, ses succès, et qui, maintenant, se révèle fausse ou simplement inadaptée.” – G. Brousseau (didacticien des mathématiques)
A l’école, lorsqu’un élève n’arrive pas à répondre aux exigences d’un adulte (et notamment de son enseignant), alors qu’il en a le désir et qu’il redouble d’effort pour y arriver, il peut être confronté à des appréciations négatives telles que « il/elle ne fait pas d’effort », « doit mieux faire », « doit travailler davantage » …
Or justement, cet élève a travaillé et fourni des efforts, mais il n’a pas les bonnes méthodes d’apprentissage, le bon état d’esprit, les dispositions psychologiques nécessaires (faible estime de soi, empêchement de penser…) ou ses particularités neurologiques (dys…) l’empêchent de faire plus. Lorsque l’élève échoue malgré ses efforts et que la difficulté responsable de cet échec n’est pas reconnue par l’adulte, l’élève se retrouve dans cette situation « d’impuissance apprise ».
Il n’a plus confiance dans ses capacités à réussir en mobilisant ses efforts, et pire, il perd confiance en la capacité des adultes à repérer ses besoins et à y répondre.
Quels leviers activer pour remotiver un enfant à l’école ?
Du côté de l’adulte : reconnaître les difficultés
Permettre à l’élève de retrouver le goût d’apprendre, c’est avant toute chose entendre sa souffrance et la reconnaître. Il faut que l’enfant perçoive que l’adulte a compris qu’il avait voulu y arriver, qu’il avait fourni des efforts, mais qu’il n’y arrivait pas car il n’arrivait pas à se concentrer, ou à tenir en place, ou qu’il avait du mal à lire, à orthographier correctement les mots (dyslexie-dysorothographie), ou à prendre des notes rapidement (dyspraxie)… Lorsque l’enfant perçoit que l’adulte a compris, l’alliance se créer et à nouveau, l’investissement de la scolarité est possible.
Adopter une nouvelle manière d’envisager l’erreur
« Apprendre, c’est comprendre pourquoi on se trompe »
C’est seulement quand l’erreur est acceptée que tout devient possible : réflexion, apprentissage, progression, création, innovation, invention !
Il incombe donc aux adultes de dédramatiser l’erreur, de faire comprendre que l’erreur fait partie du processus d’apprentissage : c’est parce que je me trompe que je suis en train d’apprendre ! Une fois que l’enfant a compris qu’il faut pouvoir se tromper pour apprendre, il pourra donner un rôle positif à l’erreur sans la craindre.
Dans cette approche, l’adulte s’intéressera plus à faire expliciter par l’enfant ce qu’il a voulu faire, plutôt qu’à ce qu’il a mal fait ou pas fait. L’adulte pourra ainsi tenter d’identifier les connaissances sur lesquelles s’appuie le raisonnement de l’enfant et en déterminer les origines possibles.
4. "Vaut mieux prévenir que guérir !" Quelques conseils
Plutôt que de guérir l’impuissance apprise, il est encore mieux de la prévenir :
- En expliquant à l’enfant que l’erreur est positive parce qu’instructive.
- En lui montrant comment il peut rebondir sur son erreur pour apprendre.
- En l’encourageant à expliquer ses raisonnements plutôt qu’en focalisant sur le résultat.
- En l’encourageant plutôt qu’en le félicitant, afin de lui apprendre à travailler pour lui, plutôt que pour faire plaisir ou non aux autres.
- En favorisant une pensée positive, de manière générale : « je n’ai pas réussi cette fois mais j’ai travaillé dur, je vais finir par y arriver », par exemple.
Notons enfin que l’impuissance apprise peut amener un enfant à se décharger de toute responsabilité : « ce n’est pas ma faute si ». S’en libérer nécessite pour l’enfant d’être entendue et reconnue dans sa souffrance, et d’être soutenue dans sa volonté au changement.
C’est pourquoi, La Brygade Scolaire met l’accent sur la confiance réciproque, les méthodes d’apprentissage, les schémas de réflexion et la fixation d’objectif. Ces aspects sont le socle permettant d’assurer une scolarité épanouie et pérenne. Sans oublier un aspect essentiel : être optimiste quant à la réussite de nos enfants !
Bonne semaine à tous !
Mustapha, La Brygade Scolaire – Votre partenaire réussite